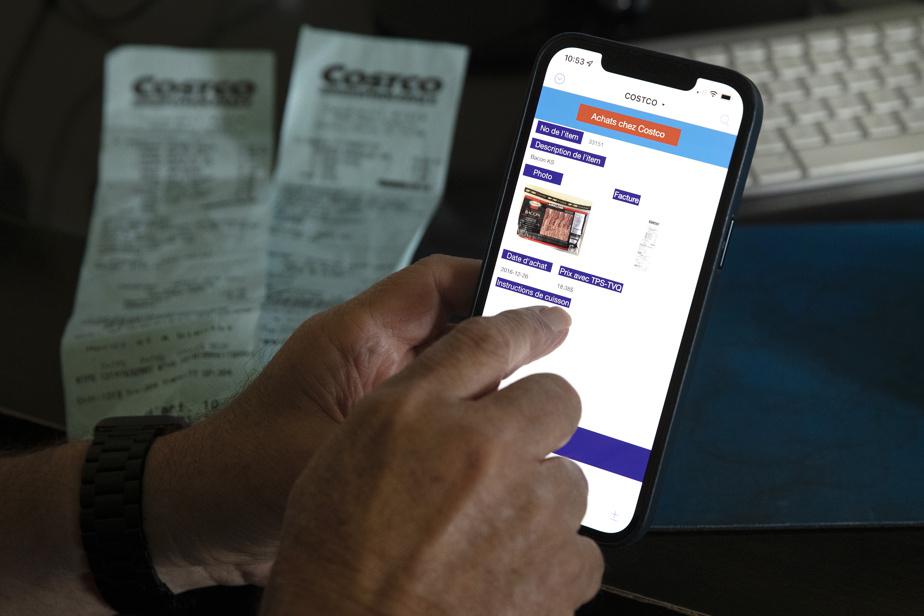Alors que les prix flambent, faut-il craindre le retour de l'inflation ?

PublicitéINFLATION
Ce qu’on peut dire avec certitude pour le moment, c’est que ce soudain coup de chaud sur les étiquettes est d’abord un dommage collatéral de la crise du Covid. Pendant de nombreux mois, le virus à couronnes a mis à l’arrêt pays et économies, renvoyé chez eux les salariés et confiné les ménages dans leurs foyers, ce qui a fait plonger la consommation et exploser l’épargne. En Europe, où les mesures d’activité partielle ont sauvegardé en grande partie les emplois et les revenus, les bas de laine ont ainsi enflé de 1.400 milliards d’euros.
Résultat : après des mois de restrictions, le monde se réveille la panse vide et les poches pleines, prêt à se jeter sur les rayons des supermarchés. Le problème, c’est que ces derniers ne sont pas du tout assez garnis pour satisfaire toutes les envies. Pendant la crise, les industriels ont en effet fortement réduit la voilure de leur production, les lignes d’approvisionnement ont été désorganisées, et des goulots d’étranglement se sont formés un peu partout. Si bien que la fourniture des produits est aujourd’hui chancelante.
C’est cela, la première cause du retour de l’inflation : le déséquilibre entre l’offre et la demande. Ses effets sont particulièrement sensibles dans les matières premières. Pour ne pas rater le train de la reprise, les industriels du monde entier se sont rués ces derniers mois sur toutes les substances de base, provoquant un affolement des cours. A l’heure où nous écrivions ces lignes, en dépit d’un léger fléchissement dû aux dernières déclarations de la Banque centrale américaine, l’acier avait bondi de 53% en un an, le cuivre de 39%, le nickel de 36%, le bois de 14%, le café de 59%, le sucre de 58%, et l’aluminium carrément de 105%, de quoi faire bouillir tous les fabricants de casseroles.
Ces hausses sont d’autant plus marquées que, comme l’observe Didier Saint-Georges, membre du comité d’investissement stratégique de Carmignac, «les producteurs de matières premières et de biens intermédiaires ne se précipitent pas pour augmenter leur offre, ils préfèrent laisser les prix monter». La désastreuse météo des six derniers mois a contribué à aggraver le mal. Partout sur la planète, les intempéries ont massacré les rendements agricoles et stressé un peu plus les marchés. Le dôme de chaleur qui s’est abattu sur la partie ouest de son territoire au cours de l’été a, par exemple, privé le Canada de 30% de sa récolte de blé dur, dont il est le premier producteur mondial…
Naturellement, ces augmentations finissent par se retrouver dans les prix payés par les consommateurs. Jouets, vêtements, alimentation, matériaux de construction… Aucun secteur industriel ou presque n’est épargné, et certainement pas celui des smartphones et autres bidules électroniques. Assaillis par la demande, les fabricants de puces ne parviennent en effet plus à faire face depuis plusieurs mois, et ils ne cachent pas que la pénurie est partie pour durer, car la construction de nouvelles unités de production prendra beaucoup de temps.
Le taïwanais TSMC, premier producteur mondial, a annoncé fin août qu’il augmentait de 10 à 20% le prix de ses composants, ce qui contraindra bientôt toute la filière électronique à réajuster les siens. Dans l’industrie automobile, la pénurie a d’ailleurs déjà commencé à faire des ravages. Faute de pouvoir se fournir en semi-conducteurs, de nombreux constructeurs ont été contraints de ralentir les cadences. Du coup, ce sont les voitures d’occasion qui raflent la mise ! Sur les sites d’annonce, les prix ont décollé comme à Roissy. Aux Etats-Unis, leurs tarifs ont crû de 25% en un an.
Pour ne rien arranger, le pétrole, dont les cours se traînaient au ras du sol, s’est mis lui aussi à flamber. Les pays de l’Opep+, qui s’étaient engagés, une fois la reprise venue, à remettre progressivement en vente les 9,7 millions de barils/jour qu’ils avaient retirés du marché en avril 2020, font en effet aujourd’hui la fine bouche. Tout juste s’ils ont accepté de relever de 400.000 barils/jour leur production à partir d’août, une misère. Du coup, entre les étés 2020 et 2021, les cours ont quasiment doublé. De quoi renchérir encore le prix des transports, déjà grevé par le doublement du prix des conteneurs, eux aussi victimes de l’explosion de la demande. «Dans le fret maritime, le retour à la normale risque de prendre du temps», prévient Philippe Chalmin, professeur à l’université Paris Dauphine, et fondateur du cercle CyclOpe.

Est-ce tout ? Pas encore. La reprise est si forte que les entreprises doivent aussi faire face à des pénuries de main-d’œuvre. Début septembre, le nombre de postes offerts par Pôle emploi a atteint le chiffre incroyable de 975.000, un record historique. Du coup, pour attirer des candidats, les entreprises n’ont souvent plus d’autre choix que d’augmenter leurs salaires.
Et c’est la même chose dans tous les pays riches. Au Royaume-Uni, la désertion des chauffeurs routiers originaires d’Europe de l’Est, affolés par la pandémie, conduit aujourd’hui à des problèmes d’approvisionnement jusque dans les pubs, à court de bière. Et, aux Etats-Unis, le salaire horaire ne cesse d’augmenter. Indice que la situation est grave, Amazon, pourtant peu versé dans le social, a offert une augmentation pouvant aller jusqu’à 3 dollars de l’heure à 500.000 de ses salariés. Pour eux, c’est sans doute une bonne chose. Mais cela risque d’alimenter une boucle prix-salaire qui sera très difficile à inverser dans le temps. «C’est comme le dentifrice : quand vous avez appuyé dessus, vous ne pouvez pas le remettre dans le tube», alerte Marc Touati, le président du cabinet ACDEFI.
Ces amorces de processus inflationnistes tombent d’autant plus mal qu’elles surviennent dans un monde gavé de liquidités. Pour éviter que l’économie ne sombre dans la dépression après la crise des subprimes, en 2008, les Banques centrales ont en effet fait tourner à plein régime la planche à billets. Elles ont ramené leurs taux d’intérêt à zéro et racheté à tour de bras des obligations avec de l’argent créé de toutes pièces. Comme elles n’ont jamais osé interrompre la perfusion – elle se poursuit encore aujourd’hui –, ce sont au total plus de 15.000 milliards de dollars qui ont ainsi été déversés dans la planète.
Or, selon la théorie économique, lorsque la masse monétaire augmente plus vite que la création de richesses, cela crée mécaniquement de l’inflation. Pour des raisons que personne ne comprend trop bien, cela ne s’est pas produit, mais on ne perd sans doute rien pour attendre. «Le monde est assis sur une Cocotte-minute», soupire Radu Vranceanu, professeur d’économie à l’Essec.
Comme si tout cela ne suffisait pas, le gouvernement des Etats-Unis n’a rien trouvé de mieux à faire que de rajouter lui-même une gigantesque louche de liquidités dans la marmite, par le biais d’une série de plans de relance. Pour faire face à la pandémie, Donald Trump avait déjà offert 3.100 milliards de dollars en 2020 (plus que le PIB de la France !) aux Américains, sous forme d’aides et de subventions. Joe Biden est revenu à la charge en faisant voter un nouveau plan de 1900 milliards de dollars en mars dernier.
Et deux autres perfusions, de 500 milliards pour les investissements d’infrastructures et de 3.500 milliards pour les «infrastructures humaines» (réparties sur plusieurs années, il est vrai), devraient venir s’y ajouter. Dans une économie déjà en surchauffe, cette délirante distribution de Noël – des millions de ménages américains ont commencé à recevoir leurs grosses coupures : 1.400 dollars par adulte et par enfant – pourrait suffire à déclencher un cycle de hausse des étiquettes incontrôlables, redoutent de nombreux experts.
Pas étonnant que les Banques centrales, dont le rôle officiel est de garantir la stabilité des prix, soient sur des charbons ardents ! Certes, techniquement parlant, elles disposent de tous les moyens pour noyer dans l’œuf la reprise de l’inflation. Le problème, c’est que leur remède – refermer le robinet à liquidités en remontant leurs taux et en réduisant leurs achats d’actifs – pourrait bien s’avérer pire que le mal.
Depuis plus de dix ans qu’on la lui sert en gants blancs, l’économie mondiale s’est en effet accoutumée à la politique de l’argent facile, qui permet aux entreprises et aux ménages d’emprunter – donc de consommer et d’investir – pour presque rien. La priver subitement de cet oxygène, alors qu’elle se remet à peine de deux ans de crise sanitaire, la plongerait immanquablement dans une profonde récession. Tous les experts sont d’accord sur ce point. Les conséquences d’un brutal resserrement monétaire pourraient aussi être terribles sur les marchés financiers.
Les cassandres y voient déjà les prémices non seulement d’un effondrement de la Bourse, mais aussi d’un nouveau krach obligataire – avec la hausse des taux, les vieilles obligations émises par les Etats perdraient une bonne partie de leur valeur, plongeant tous leurs possesseurs dans la difficulté – susceptible de mettre des banques au tapis.
Mais ce sont sans doute les Etats surendettés qui paieraient l’addition la plus salée. Une éventuelle hausse des taux renchérirait en effet immédiatement la facture de leurs remboursements d’emprunts, ce qui alourdirait encore leurs déficits et les obligerait à… emprunter encore plus, au risque de perdre la confiance des marchés. C’est cette désastreuse spirale qui a failli emporter la Grèce en 2010. A ce jeu du qui perd perd, la France, désormais endettée à hauteur de 118,7% de son PIB, pourrait laisser pas mal de plumes. Mais ce sont l’Espagne et surtout l’Italie qui se trouveraient en première ligne.
Dix ans après avoir failli être balayée par la crise grecque, l’Europe, dont les mécanismes de défense restent embryonnaires, pourrait-elle encaisser ce nouveau choc ? Aucun économiste n’y mettrait sa tête à couper. «La situation risque d’être extrêmement tendue entre les pays du Sud, qui préféreront toujours l’inflation à la hausse des taux, et ceux du Nord, plus vertueux, qui se demandent déjà jusqu’où ils pourront les soutenir dans cette voie», résume Radu Vranceanu.
Voilà pourquoi les Banques centrales font aujourd’hui montre d’une extrême prudence. Fin août, au symposium de Jackson Hole, le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a pris des pincettes pour annoncer que «si l’économie évoluait comme prévu, il pourrait être approprié de commencer à réduire le rythme des achats d’actifs cette année». Cela a suffi pour faire plonger (un peu) les marchés.
Mais pour le moment, en dépit des pressions du camp de la rigueur, ni lui ni Christine Lagarde, son homologue de la BCE, n’ont encore bougé un orteil. Et aucun des d’eux n’est allé jusqu’à évoquer une éventuelle remontée des taux d’intérêt, l’arme de destruction massive de l’inflation… et de la croissance. Sans doute espèrent-ils encore, comme certains économistes, que la hausse des prix se calme d’elle-même. «Ce n’est pas un phénomène durable. S’il y a une inquiétude aux Etats-Unis à cause des hausses des prix des matières premières des derniers mois, ce n’est pas le cas en Europe, où l’inflation sous-jacente reste très faible», rassure par exemple Patrick Artus (Natixis).
Les optimistes font aussi valoir que, le jour où il interviendra, le resserrement monétaire suscité par les Banques centrales sera dosé au trébuchet pour faire le moins de dégâts possibles. «Il faut faire la distinction entre une politique moins accommodante et une politique restrictive, nuance Christophe Barraud, chef économiste chez Market Securities. La Fed va continuer à acheter des actifs, juste un peu moins qu’avant, donc il n’y aura pas de choc négatif avant des années.»
Reste une dernière raison de garder espoir : si les injections massives de liquidités de ces dernières années n’ont pas fait s’envoler les prix, comme la théorie économique le prévoyait, c’est que, dans notre monde globalisé, les facteurs structurels déflationnistes sont légion. Généralisation des technologies numériques (qui fait baisser les coûts de production), présence d’une main-d’œuvre nombreuse prête à travailler à bon marché dans les pays du Sud (qui fait baisser les salaires), concurrence internationale exacerbée (qui pousse les entreprises à baisser leurs étiquettes)… Allez, le combat contre la hausse des prix n’est peut-être pas perdu d’avance.
Vade retro, inflationas !
>> Spécial retraite : ce qui va changer pour vous. C’est la Une du dernier numéro de Capital. Accédez en quelques secondes à cette édition à partir de 3,90 euros.
- PRÉC
- SUIVANT