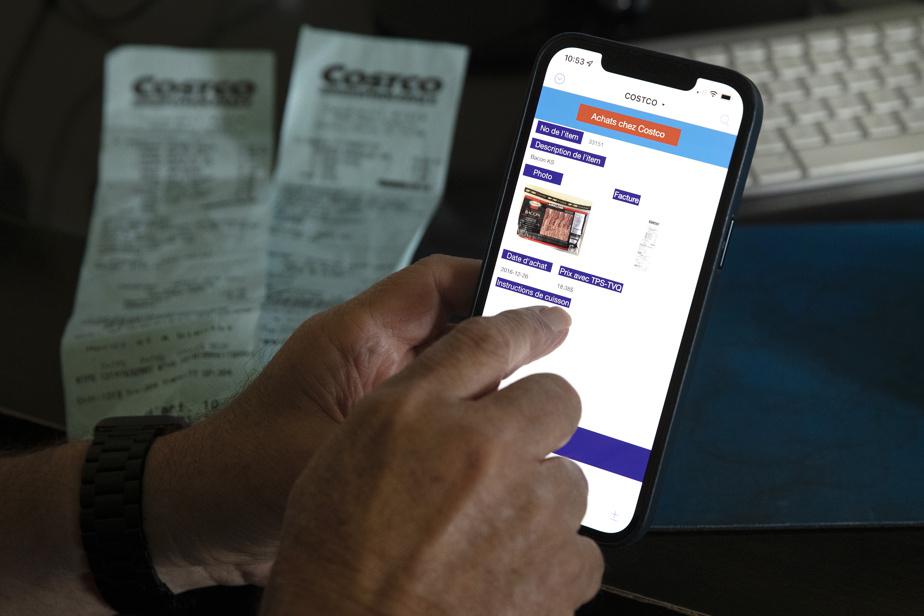C'est mon histoire : « J'ai vécu mon pire cauchemar : être enceinte »

Pour Louise, la grossesse représentait une première étape vers la privation. Le jour où elle tombe enceinte, elle décide de garder le bébé, et de refaçonner son quotidien.
ParLucile QuilletQuand j'ai vu le test de grossesse positif, j’ai tout de suite dit à mon mari : « Désolée, en fait, je ne peux pas. » C’était au-dessus de mes forces. Je m’étais lancée dans ce projet d’enfant de façon très rationnelle, quasi-militaire, mais, désormais au pied du mur, la panique m’a gagnée. Trois jours après, le courage et la raison prenaient à nouveau le dessus : j’avais décidé d’avoir cet enfant, j’allais m’y tenir. Mais à ma façon. Je n’ai jamais été certaine de vouloir un enfant. Il faut dire que jusque-là j’aimais mon confort de vie et mon indépendance… De plus, mon corps, léger et tonique, était la clé de voûte de ma liberté : je me sens bien quand je me trouve souple, agile, tel un petit cabri capable de tout. Je suis très vigilante sur mon alimentation, j’aime ma minceur. Ma vie était faite de grasses matinées, d’escapades le week-end, de déplacements professionnels excitants, de longs breaks lecture et de très bons verres de rouge. Un enfant pour moi représentait la fin de tout ça. La grossesse en elle-même me semblait être la première étape d’un long chemin de croix. Je voyais des copines se faire vampiriser par un embryon, oubliant complètement qui elles étaient auparavant.

ESCLAVAGISME MODERNE
Les onze ans qui me séparaient de mon petit frère avaient fait de moi quelqu’un de lucide. Je mesurais très bien ce qu’était la gestion de la petite enfance, le considérable déploiement d’énergie requis. Avoir un enfant, c’est se plier à l’autre, s’adapter à son timing, ça vous décentre complètement. J’entends encore dans ma tête ma mère répéter qu’elle n’avait pas « une minute à elle », malgré la nanny, la femme de ménage et la belle-mère. Elle faisait passer la parentalité pour de l’esclavagisme moderne, tout en soutenant que ne pas vouloir devenir parent était un réflexe d’égoïste. « On ne vit pas pour soi », disait-elle. Maintenant, je sais que c’était surtout une posture qu’elle se donnait. En attendant, moi, je ne voulais pas être l’esclave d’une chose hurlante. J’avais beau habiter au centre de Paris, à deux pas de nos familles et de nos bureaux (un luxe !), avoir un emploi stable, un couple solide, toutes les « bonnes conditions », je n’avais jamais eu envie d’enfants. On pouvait me considérer comme une égoïste, je m’en fichais, c’était ma vie et je ne voulais pas la bouleverser. Quand j’établissais une liste, les « contre » étaient plus nombreux que les « pour ». L’idée même d’une grossesse me terrorisait. Vivre pour nous, pour moi, ça m’allait très bien. Pour mon mari, en revanche, une vie sans enfants était inenvisageable. Je le savais depuis le début. L’épouser signifiait adhérer à son désir de paternité, il aurait été cruel de faire semblant de l’ignorer, et de l’en priver. En parallèle, des amies quadragénaires me confiaient leur regret de ne pas avoir sauté le pas… Huit mois après notre mariage, le sujet a naturellement été posé sur la table (mon stérilet arrivait à expiration) et j’ai craqué, j’ai fini par dire « O.K. ». C’était comme sauter en parachute, j’avais peur, mais je l’avais choisi. En parfaite « control freak », je voulais tout cadrer au maximum. Si possible, tomber enceinte au printemps pour accoucher l’hiver (j’ai des problèmes de circulation du sang l’été), si possible dans l’année du Cochon (mon médecin chinois me l’avait conseillé) et si possible par césarienne (l’idée de haleter tel un petit chien en panique en écoutant les « allez, on y va » me révulsait).
VIN ROUGE CONTRE JUS D’HERBES
Un mois après avoir enlevé mon stérilet, le test est positif. Je panique puis me reprends. Personne ne m’a forcée à avoir un enfant. Il faut assumer : lui ne demande pas à naître, alors je me dois de lui donner le meilleur. Combattre la nature m’amusait déjà d’ordinaire, alors j’ai pris la grossesse comme un challenge physique, pour ne pas me sentir soumise à cette condition. Je ne « parle » pas à mon bébé, en revanche, je lui donne des preuves d’amour en étant responsable. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à être mère. Je troque mon verre de vin rouge contre un shot de jus d’herbes, suivi d’un autre d’huile de germe de blé à jeun tous les matins, une vraie bombe nutritive. Fini les produits à base de lait de vache, à moi l’eau minérale chargée de calcium pour ses os. Fini les sushis, bonjour les poissons gras bien cuits. Je mange des légumes par tonnes. Sans faillir à ses besoins, je prends huit kilos au total. Au fil des mois, je continue à me reconnaître dans le miroir et à garder ma mobilité. Je refuse de laisser mon identité se faire coloniser par la grossesse. Mon corps est là pour mon enfant, mais point trop n’en faut. Le fœtus est le locataire d’une chambre dans un appartement qui m’appartient et nous allons cohabiter en bonne intelligence. J’ai de la chance : je peux continuer à exercer mon métier, et à bouger, car mon corps peut suivre. Il me faut tenir à distance le regard des autres – qui me reprochent comme d’habitude d’être trop mince. Ils convoquent constamment cette imagerie niaise du « monde de bébé » et ces mots infantilisants qui me font horreur : les « tétées », le « bidou »… Je fais la sourde oreille aux suggestions intrusives et aux remarques misogynes qui nous tombent constamment dessus. Je me suis bien informée, entourée de médecins visionnaires : je sais exactement ce que je fais. À l’annonce de ma grossesse, les amis, déjà pères, de mon mari plaisantaient : « Tu vas voir, tu ne vas pas la reconnaître. » Il attend depuis fébrilement ce moment où je suis censée devenir « folle », sauf que… ce moment n’arrive pas, je reste moi-même, confiant à ma belle-mère : « Ça pèse lourd ! J’ai l’impression d’avoir avalé un sac de sable ! » Elle rit, bien plus compréhensive que d’autres, qui, plus jeunes, sont outrées par mes propos. Jouer la comédie de la femme enceinte débordante et auréolée, la main sur le ventre tout le temps, juste pour coller à l’image que se fait la société des futures mères ? Hors de question. Si je me sens comme un four, j’ai le droit de le dire. Les derniers mois sont difficiles. J’ai l’impression d’être une boîte contenant un colis trop volumineux, j’étouffe, mes poumons sont écrasés, la tête du bébé me rentre dans les côtes, je dois rouler pour me lever. Je déteste dormir sur le dos, je sature des jus d’herbes et des sardines en conserve et compte les jours comme un prisonnier attendant sa délivrance. Je supplie mon gynéco : « Pas une semaine de plus enceinte, je me tape la tête contre les murs ! » Ma fille savait-elle chez qui elle arrivait ? Trois semaines avant le terme, elle se positionne en siège : césarienne obligée. J’ai le sentiment qu’elle m’a entendue. J’accouche deux jours avant la fin de l’année du Cochon. On a fait du bon boulot, elle et moi.
UN RAYON DE SOLEIL
Je n’ai pas d’instinct maternel, mais je l’aime immédiatement. À la clinique, je laisse mon mari apprendre au côté de la sage-femme comment changer une couche… Le seul homme au milieu des mères convalescentes. Moi, j’ai donné neuf mois de ma vie et suis passée au bloc… fichez-moi la paix et laissez-moi me reposer devant la télé. À certains moments, je regrette ma vie d’avant, mais je ne regrette pas d’avoir fait un enfant. J’ai changé, mais je ne suis pas devenue quelqu’un d’autre. Je suis moins légère, moins insouciante, moins détendue, mais pas moins heureuse, je vis juste différemment. L’arrivée d’un enfant est un révélateur : soit ça passe, soit ça casse. Je suis heureuse de découvrir que mon mari et moi formons vraiment une bonne équipe. Même si l’on s’agace par moments, nous sommes bienveillants, nous ne nous jugeons pas, ni lui ni moi ne la jouons « perso », nous rions des situations cocasses, nous nous reposons l’un sur l’autre. Cette cohésion rend tout plus facile. Il gère le pédiatre et les nuits (pendant que je garde mes boules Quies), je m’occupe de la nourriture et des habits. Il ne « m’aide » pas : il est juste un père, 50 % de l’ADN de notre enfant, 50 % du travail et de l’éducation. Je ne sais pas si c’est la grossesse, l’éducation, sa nature, ou les trois à la fois, mais notre fille est un rayon de soleil. J’ai beaucoup de plaisir à l’éveiller au monde, j’ai une tendresse infinie devant ses petites mains maladroites, ses premiers pas et toutes ses premières fois, même quand il ne s’agit que de manger une carotte. Je crois qu’elle a compris qu’elle sera aimée, que je serai toujours là pour elle, qu’elle aura sa place – mais pas toute la place. Je ne pourrai jamais n’être « que » sa mère et elle ne pourra jamais n’être que ma fille. Je suis là pour la guider et pour qu’elle n’ait, un jour, plus besoin de moi.
- PRÉC
- SUIVANT