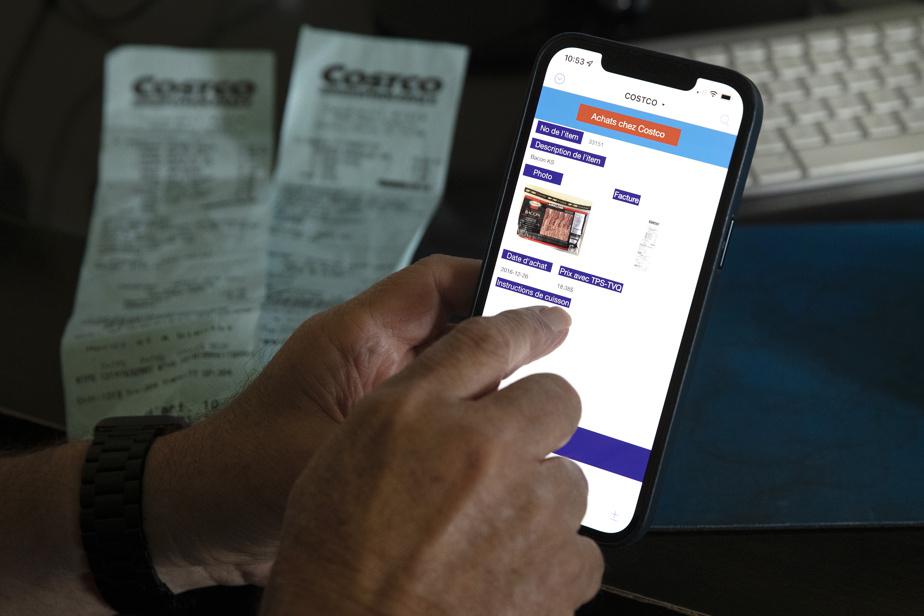Et Thierry Mugler inventa le défilé-spectacle - Elle

Son univers peuplé de créatures de rêve et de femmes mutantes a marqué l'esthétique des 80s. Une exposition revient sur l'épopée Mugler, rappelant le génie de ce créateur visionnaire.
ParCarine BizetEva Herzigova, mi-oiseau de paradis mi-mutante reptilienne, un essaim de femmes-insectes gainées de latex, la bouche hémoglobine prête à tout dévorer, Emma Sjöberg en diva carrossée façon Harley-Davidson… L'univers de Thierry Mugler a laissé bien des clichés dans l'imaginaire collectif. Des clichés dans tous les sens du terme, quitte à ce que certains les classent au rayon « caricatures ». Mais la culture des réseaux sociaux, toujours avide de photogénie spectaculaire, a ajouté une couche – virtuelle et virale –au mythe Mugler né pourtant avant l'ère du tout-numérique. Le couturier et son travail font aujourd'hui l'objet d'une exposition au musée des Arts décoratifs à Paris, sous la direction de Thierry-Maxime Loriot qui avait orchestré la première version de l'événement à Montréal, en 2019. Celui-ci a su balayer les superlatifs, mettre en perspective une vision iconoclaste, vibrante et complexe. En filigrane, on lit aussi une histoire intime et singulière où l'œuvre et l'homme sont indissociables.
Créer son monde
L'intéressé se décrit lui-même comme « un créateur de rêve, un combattant de la beauté ». Pour Mugler, le combat en question a commencé tôt. C'est celui d'un gamin étouffé par le microcosme bourgeois de Strasbourg, entre un père médecin dans un spa et une mère excentrique, mélange improbable de Norma Desmond et de Jessica Rabbit. À la manière d'un Tim Burton, môme en butte à la langueur terne des banlieues de Los Angeles, il choisit l'évasion et la construction de son propre monde : « C'était plus fort que moi, un truc instinctif. C'est ma vie, et je suis incapable de faire autre chose. Heureusement que j'ai eu un peu de talent sinon j'aurais fini clochard », s'amuse-t-il. Rebelle, l'adolescent sèche le lycée, préfère les bonnes sœurs qui chantent à la cathédrale, bricole ses vêtements et bâtit déjà des petits théâtres en carton. « Je ne comprenais rien à cette famille et à ce monde, je suffoquais, donc j'ai commencé à créer mon monde à moi comme je pouvais, le monde tel que je le voyais à travers les musées, le cinéma, la nature, les animaux… » En guerre contre l'ordinaire, il poursuit son combat en travaillant sur sa propre personne. Thierry Mugler le danseur entre en scène. « La danse m'a sauvé, dit-il. La quête de l'équilibre, la volonté de se dépasser pour aller plus loin, plus haut, cela me correspondait bien et cela m'a suivi dans la création de mes vêtements. » C'est dans cette discipline presque ascétique que résident alors le bonheur et le succès. « Une fois qu'on a fait l'effort de maîtriser la technique, on vole, on est comme défoncé. Comme les acteurs qui connaissent leur texte par cœur, on peut aller au-delà, interpréter. »

Jouer avec les extrêmes
Danseur à l'Opéra national du Rhin, Thierry Mugler « monte » à Paris en 1968. C'est la révolution dans la rue, lui entame la sienne en coulisses. Il passe des auditions de danse et découvre le métier de « styliste » : à l'époque, les grandes maisons de couture n'ont pas de designers attitrés, elles achètent des dessins à des stylistes. Il prend donc les crayons. Bientôt, le danseur devient « sculpteur » : surgissent des architectures a(na)tomiques qui glorifient le corps, des volumes sensuels qui donnent le vertige. La maison Mugler voit le jour en 1974, le premier défilé aura lieu en 1975. Au fil des shows naît une galerie de personnages extraordinaires. Si chez Tim Burton on croise les inoubliables Edward aux mains d'argent et autre Enfant Huître, chez le jeune créateur les « misfits » ont l'excentricité plus joyeuse et triomphante. Insectes, fauves, guerrières, femmes fatales futuristes… leur allure tranche avec les archétypes somnolents du bon goût dit parisien. Mugler, lui, est tout sauf un Parisien. Plutôt un globe-trotteur qui se nourrit de voyages et d'expériences. Il vit un temps à Londres, passe cinq ans sur une péniche à Amsterdam. L'homme qui aurait rêvé d'être un aventurier à la Youri Gagarine explore les pays de l'Est en pleine guerre froide, traverse l'Afghanistan en van, passe de Calcultta à Osaka. Tout le capte, surtout quand c'est « extrême ». Un mot qui le définit bien ? « Quand je lui ai posé la question, confie Thierry-Maxime Loriot, il m'a dit : “Écoute, j'ai été danseur de ballet, yogi, hippie, danseur kathakali en Inde [théâtre traditionnel du Kerala, ndlr], j'ai travaillé dans des boutiques, j'ai été couturier, photographe, metteur en scène et, en plus, j'ai entrepris une transformation physique extrême, je suis d'une discipline extrême. Oui, je crois que l'on peut dire que je suis extrême. »
Adriana Karembeu sur le podium du défilé Thierry Mugler Haute Couture automne-hiver 1997-1998 à Paris © Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
La fin d'une aventure
L'homme de l'extrême, donc, s'installe dans une maison de couture de onze étages, rue des Archives, à Paris. Aux ateliers des couturières répondent quatre sous-sols réservés aux laboratoires, où les bains de chimie côtoient un poste de soudure. Un vrai paradis du glamour version Frankenstein. Le combat pour donner vie aux idées du couturier prend ici tout son sens. Le monde Mugler électrise les années 1980 et 1990. On se marche dessus pour assister aux défilés de celui qui se paie même le luxe de dire « non ». « Non » à Bernard Arnault, à la tête du tout jeune groupe LVMH, qui lui propose de prendre la suite de Marc Bohan chez Dior, en 1989. « Non » à Madonna aussi, la star absolue de l'époque qu'il aurait envoyée promener. Mais l'extrême, parfois, ça fâche. Immortalisée par Guy Bourdin et Helmut Newton, la sophistication charnelle de Thierry Mugler est bientôt taxée de « pornographique », puis de « dépassée » par ceux qui n'ont pas compris que son combat est ailleurs : dans la construction d'un monde à la beauté hors norme, résistant à toute classification morale, sociale, économique. Mais le monde réel se convulse sur fond de guerre du Golfe et des crises financières. Dans la couture émergent de grands groupes qui vont formater une « industrie » avide de profits, mais aussi une mode grunge, minimaliste, voire brutaliste. Sur cette scène-là, le créateur n'aura dès lors plus sa place. Il quitte la mode en 2003, « parce que ce n'était plus un véhicule émotionnel ou artistique », avance-t-il, intransigeant.
Se réinventer, toujours
La mode garde, en tout cas et pour longtemps, des traces de son passage. En bousculant les codes de la haute couture, Mugler a ouvert des portes que pulvériseront bientôt les génies « made in Britain », de John Galliano à Alexander McQueen, ce dernier revendiquant ouvertement l'héritage « muglérien ». Et les années 2020 continuent d'exploiter plus ou moins à demi-mot le vocabulaire esthétique du couturier, avec des vestes épaulées, leggings en latex et autres jupes sirènes qui affolent les tapis rouges. C'est que, dévoué corps et âme à sa démarche personnelle, sans autre but qu'elle-même, Thierry Mugler est bel et bien un précurseur. C'est lui qui invente le défilé-spectacle, qu'il met en scène et contrôle de A à Z, loin de l'ambiance ampoulée des petits salons couture traditionnels. Pour les dix ans de sa marque, le 22 mars 1984, 6 000 personnes (dont 4 000 places payantes) se pressent au Zénith de Paris. Sur ses podiums, Cyd Charisse, Celia Cruz, l'icône « drag » Joey Arias, Diana Ross et Julie Newmar partagent la vedette avec les plus spectaculaires top models. L'union naturelle de la mode et du show-business qu'il a impulsée dure toujours mais n'a jamais vraiment retrouvé cette intensité. La culture Mugler investit à cette époque la culture pop : le couturier habille Bryan Ferry, les Pet Shop Boys, David Bowie (qui opte pour du prêt-à-porter féminin, car non, les années 2020 n'ont pas inventé le « gender fluid »), Niagara, les Rita Mitsouko, Mylène Farmer…, il réalise le clip « Too Funky » de George Michael (il n'est pas crédité sur la version finale) et entre dans la légende dans ces années MTV, pré-réseaux sociaux.
Et si, aujourd'hui, il semble tout à fait naturel pour la mode de jouer avec le caoutchouc, les résines thermoformées, le latex, le métal ou autre matériau industriel, c'est bien Thierry Mugler qui les a imposés en couture. Avec la complicité du sculpteur plasticien Jean-Jacques Urcun, il se tourne vers les technologies de l'industrie aéronautique ; ensemble, ils inventent aussi bien des carapaces de femmes-robots en chrome que le flacon du mythique Angel, lui-même précurseur de la déferlante des « parfums bonbons » à venir. Ancêtre des directeurs artistiques touche-à-tout, Thierry Mugler a aussi été le premier à se lancer dans l'aventure de la photographie au milieu des seventies, histoire de mieux contrôler « son » monde. Enfin, dans ses corps transformés par la magie de la couture, on peut voir les premiers élans d'un transhumanisme qui ne demande qu'à s'exprimer aujourd'hui à travers la réalité augmentée ou les progrès de la chirurgie plastique. Le monde moderne, biberonné aux films de super-héros Marvel et DC Comics, ne rêve que de cela.
L'humanisme sous les excès
Mais la mode n'étant qu'un des aspects de l'œuvre muglérienne, l'exposition du musée des Arts décoratifs explore aussi le combat d'après. Celui du metteur en scène, qui l'a mené de Berlin (pour « The Wyld ») à Las Vegas (pour le spectacle « Zumanity », créé avec le Cirque du Soleil). « Certains artistes sont venus me dire : "Vous avez révélé en moi des choses que je ne soupçonnais pas" », sourit-il. Comme si en se construisant lui-même, il contribuait à aider les autres à le faire. Et, dans cette forme d'humanisme tapi sous les excès, on est tenté de voir une raison inconsciente à son succès continu. Car il y a bien un nouveau public Mugler : des jeunes anonymes qui chinent ses créations sur les réseaux sociaux, comme les nouvelles divas du show-business que sont Beyoncé, Lady Gaga, Cardi B ou Kim Kardashian. Le créateur a changé de nom (il a repris son premier prénom, Manfred, en 2013), a changé de physique (à force de réparer son corps de danseur meurtri, il est devenu semblable à ses héros de bande dessinée). Mais lui n'a pas vraiment changé ; l'âme du danseur discipliné est toujours là et ses yeux brillent quand il parle de son nouveau projet avec le Bolchoï et l'étoile Svetlana Zakharova, monstre sacré du ballet, extrême, elle aussi, dans son genre. D'elle il parle comme un enfant, décrit avec admiration sa maîtrise inouïe de la gestuelle du poignet. Pas de doute, Thierry Mugler est toujours ce gosse rêveur et volontaire. Et on pense à la formule de Picasso : « Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. »
- PRÉC
- SUIVANT