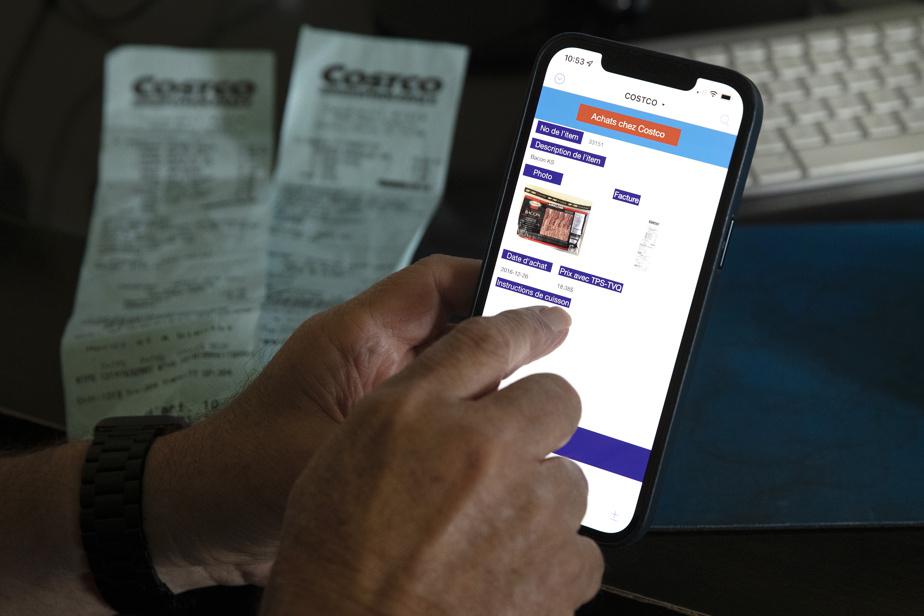Ados en souffrance : un hôpital pour sauver sa peau

Son drap lui a été retiré, tout comme sa couverture, remplacés par les deux boutis matelassés bleus du « kit anti-suicide ». Et, chaque fois qu’elle est seule dans sa chambre, Camille* doit désormais rendre ses vêtements et enfiler un pyjama en papier. Ce samedi matin, sur la grande table du poste de soins, deux longues vis de 8 centimètres sont posées près d’un morceau de plastique coupant qu’elle a elle-même remis aux soignants. « Les vis venaient de l’interrupteur ; le plastique, du contreplaqué de la fenêtre », explique Delphine, l’infirmière. Camille aurait pu se faire très mal avec… Deux jours plus tôt, la jeune fille aux bras couverts de plaies profondes et d’hématomes a déjà fait une tentative de suicide (TS) avec son drap, qu’elle avait déchiré et attaché au sommier de son lit avant de le passer autour de son cou. Depuis, elle est dans la chambre 110, la plus proche du poste de soins, tour de contrôle du service. Son traitement va être réévalué et on va augmenter ses sédatifs.
L’unité psychiatrique pour adolescents Upsilon regroupe 15 lits. « On accueille des ados qui ont voulu se tuer, qui sont atteints de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), de troubles anxieux vis-à-vis de la scolarité pouvant les mener jusqu’à la déscolarisation ; des enfants qui s’auto-agressent en se scarifiant, qui consomment des drogues. Certains ont été témoins ou victimes d’actes graves, de maltraitance de diverses natures », précise le Pr Manuel Bouvard, chef du pôle psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Multiplication des écrans, immigration, questions de genre, la pédopsychiatrie est confrontée à l’évolution de la société. Mais pas seulement. « L’humain, c’est compliqué. Ce serait une absurdité d’opposer la psychologie à la biologie », résume le médecin psychiatre. Qui rappelle aussi que la consommation de cannabis pendant l’adolescence augmente les risques d’entrée dans la schizophrénie. Cette unité est souvent le dernier recours pour des familles qui ne s’en sortent plus. Comment dire que votre propre fils vous frappe ? Que faire de ces jeunes dont la société ne veut pas, comme cette gamine de 12 ans à la tête d’un réseau de prostitution, ce revenant d’Irak et ces mineurs isolés étrangers ? C’est le cas d’Acha*, 16 ans, un gaillard au physique d’athlète. Né au Cameroun, il a traversé douze pays en deux ans. Dans le désert, il a vu mourir 325 personnes sur 350. Parmi elles, des femmes, des enfants, des bébés. En mer, il a perdu son ami Moussa qui venait de lui donner le vieux pneu qui lui servait de bouée… Et chaque nuit, avant d’arriver ici, il revivait ce voyage en enfer. « Ils ont des histoires pires que dans les films », glisse une aide-soignante.
80 % des filles hospitalisées ici ont subi des abus sexuels
A la fin du XIXe siècle, le centre Charles-Perrens, à Bordeaux, était considéré comme un asile modèle. Il fait partie des rares hôpitaux situés dans la ville « à une époque où l’on préférait envoyer les fous à l’extérieur », raconte le Pr Bouvard. Ce samedi, en fin de matinée, infirmiers et aides-soignants sont réunis autour du psychiatre Jean-Philippe Rénéric, responsable du service et médecin de garde ce jour-là. Ils font le point avant les sorties du week-end. De dimanche à lundi, Alicia* va partir dans une famille d’accueil temporaire. Elle a 16 ans. Sa mère a disparu depuis sept ans sans laisser de trace. Alicia ne peut plus voir son père, condamné pour des attouchements. Comme elle, 80 % des filles hospitalisées ici ont subi des abus sexuels. Alicia a erré de foyer en foyer, se scarifie, enchaîne les fugues durant lesquelles elle se met en danger. Parce qu’elle a menacé à plusieurs reprises de sauter du troisième étage du dernier établissement où elle avait été placée, celui-ci refuse de la reprendre. Elle est là depuis plus de six semaines, alors que la durée moyenne d’hospitalisation est de vingt jours. « Pour qu’elle sorte, encore faudrait-il qu’elle ait un endroit où aller », admet le Dr Rénéric. Son dossier a pourtant été classé prioritaire par le département.
Près de la moitié des patients que nous avons rencontrés lors de ce reportage sont placés dans des foyers. « Avant, on pouvait assez vite hospitaliser un jeune puis organiser la suite : le retour, l’aménagement de la scolarité. Aujourd’hui, tout est bloqué car tout est saturé », déplore Amina Abdelkrim, une des deux psychologues. Les centres médico-psychologiques (CMP), par exemple ; il faut compter entre six mois et un an pour obtenir un premier rendez-vous. Résultat : des jeunes qui auraient pu être pris en charge plus tôt déboulent aux urgences et atterrissent ici. Lors du « débrief » vient le cas de Camille. Sa mère a demandé à la voir, ce qui lui est refusé pour le moment. « Si vous pensez qu’elle est mieux avec vous que dans les bras de sa mère… », a-t-elle lâché au téléphone. « Elle panique », analyse Delphine. Cette privation de contact est souvent difficile pour les proches.

Le lendemain matin, au petit déjeuner, Camille, Thomas* et Lola* se lancent, entre deux tartines de pain beurré, dans une discussion sur la schizophrénie. Lola évoque le cas de sa mère : « Elle parle et puis, d’un coup, elle s’arrête et se fige. » Thomas croit savoir qu’il s’agit d’un dédoublement de la personnalité. « Non, ça, c’est bipolaire », rétorque Camille. « Moi, j’entends des voix et je vois la personne ; on me dit que c’est de l’angoisse », renchérit Thomas. Delphine, l’infirmière, intervient pour expliquer que le cerveau des jeunes n’est pas « fini » et que les choses ne sont pas fixées. « Ça se guérit, la schizophrénie ? » interroge Camille. Thomas secoue la tête. Delphine nuance : « Il y a des traitements qui stabilisent. » Tous cherchent à mettre des mots sur leurs maux. « Poser un diagnostic qui peut ne pas être définitif permet de déterminer des stratégies d’intervention et d’anticiper l’avenir de ces enfants », indique le Pr Bouvard. Ce diagnostic s’accompagne la plupart du temps d’un traitement. Les antidépresseurs sont très controversés : les parents y sont presque toujours opposés et la communauté médicale hésite aussi. « Il y a les effets secondaires. Il est aussi plus facile de dire : “Mon enfant a un problème au cœur” que “mon enfant a une maladie mentale” », constate Marine, interne en psychiatrie. Et Manuel Bouvard d’ajouter : « Quand on dit à un patient qu’il est schizophrène, ça ne signifie pas qu’il est condamné à mort ou à finir ses jours dans un asile. Mais qu’il aura un traitement à vie, qu’il devra être suivi et accompagné. » Qu’ils acceptent le soin et c’est déjà la moitié du travail accompli.
Cet après-midi, les ados jouent au ping-pong, à la Wii. Ils ont l’air de jeunes comme les autres. Sur les canapés colorés, les filles chahutent, se prennent dans les bras, sont rappelées à l’ordre : contacts physiques proscrits. Des couples se forment malgré tout. « Ce n’est pas le lieu pour les relations amoureuses », répète un infirmier. « Il faut qu’ils se protègent », rappelle le médecin. Certains arrivent à masquer leur mal-être. C’est alors que le savoir-faire et l’expérience se déploient. « Notre boulot consiste à observer pour repérer ce qui cloche, au niveau somatique ou dans le comportement », explique Delphine. Elle qui travaillait au service marketing d’une grande enseigne de cosmétiques s’est reconvertie à 33 ans. « J’avais besoin de donner un sens à ma vie », dit-elle. La disponibilité doit être permanente. Les moments informels – repas, coucher, temps en chambre – sont essentiels. Après des enfances cabossées, beaucoup souffrent de carences affectives. « Là, ils sont en sécurité. On s’occupe d’eux, on leur donne à manger, on rigole. Certains aimeraient rester mais ce n’est pas un lieu de vie », confie l’infirmière. A ses débuts ici, il y a cinq ans, elle s’attachait beaucoup aux jeunes pensionnaires. Elle a appris à oublier. « On ne peut pas tout garder. Derrière un ado, il ne faut pas voir uniquement l’enfant violé ou l’enfant dont le père a tué la mère… »
Il y a trois mois, Mélanie*, 15 ans, a été vue en préadmission et inscrite sur la liste d’attente de l’unité pour « fléchissement thymique, idées suicidaires et majoration des scarifications ». Manucure soignée, yeux maquillés et longue robe à rayures, elle se présente avec ses parents dans la salle de musique. Aude, une infirmière, lui décrit le service et ses règles. « On est quinze infirmiers, six aides-soignants, une assistante sociale, un psychomotricien, des cadres de santé, des médecins, deux psychologues, ça fait beaucoup de monde… » Puis elle lui annonce qu’elle n’aura pas droit au téléphone portable. Que, pendant les premières 48 heures, elle n’aura pas de contact avec sa famille et que ses affaires personnelles seront placées dans son placard fermé à clé. Elle devra faire appel à un membre de l’équipe pour prendre ce dont elle aura besoin. Cet « inventaire strict » (IS) sera levé si tout se passe bien. Puis Aude passe en revue le contenu de la valise. Elle rend gâteaux et céréales aux parents, cherche un éventuel rasoir ou un miroir, également interdits. Mélanie se met à pleurer : « On dirait une prison… » Son père lui caresse le bras en chuchotant : « Elle va super mieux depuis la dernière fois. » La mère rectifie : « Elle va mieux mais pas super mieux. »
Aude essaie de les rassurer ; cette hospitalisation n’est pas une punition. Pendant que Mélanie visite les lieux, elle croise Théo*, 14 ans, arrivé il y a un mois. Ou, plutôt, revenu il y a un mois. « J’ai fait une dépression et j’ai été hospitalisé à l’Unité de soins aigus pour adolescents (Usaa) juste à côté, pendant six mois », me souffle-t-il un peu plus tard. Avec sa voix douce, ses cheveux en bataille et son visage arrondi, il a l’air d’un enfant. « La dépression, je ne savais même pas que ça existait. Je pensais que c’était bidon, des gens qui étaient mal pour être mal. Maintenant, je sais que c’est une vraie maladie. » Théo aime l’effet colo du groupe. Il apprécie de pouvoir parler de ses problèmes avec les autres. « A l’extérieur, ils ne sont pas en capacité de comprendre. » Avant, il pensait que ce service était réservé « aux fous, à ceux qui se tapent la tête contre les murs ou agressent les gens gratuitement ». Il résume ce qu’il a découvert : « Des gens en souffrance… » Se reprend : « Enfin, à l’Usaa, il y en a qui sont bien tarés. » Un jour, il s’est fait courser dans le couloir par un patient qui voulait l’étrangler. « J’en rigole, mais, sur le coup, j’ai eu peur. »
Depuis le bâtiment Upsilon, on accède à l’Usaa par un couloir. Mais il faut d’abord franchir une porte qui s’ouvre, comme les autres, avec un badge. Cette unité plus petite, qui compte cinq chambres individuelles et une chambre de soins intensifs, est réservée aux crises les plus aiguës. Moins d’activités proposées aux jeunes mais des horaires plus libres. Ce jour-là, Jules* avait été placé en « chambre d’iso » (pour isolement). Il avait refusé le temps en chambre imposé et s’était énervé. Cinq soignants d’autres services sont arrivés en renfort. Mais il a voulu forcer le passage et a craché au visage d’une infirmière. L’équipe a décidé de le placer 24 heures dans cette pièce vide, avec un coin toilettes et, pour seul mobilier, un lit composé de deux gros matelas empilés l’un sur l’autre. Les liens de contention en tissu pour attacher les mains et les pieds au lit sont rarement utilisés. « Longtemps, la psychiatrie a considéré la contention comme pouvant être thérapeutique, facteur d’apaisement, rappelle le Pr Bouvard. La loi a changé en 2016 et cette privation de liberté ne peut désormais se faire qu’au nom d’éléments de sécurité. »
On ne sort pas guéri de l’hôpital. Nombre de patients devront être suivis à l’Unité de traitement ambulatoire pour adolescents (Utaa), située dans le bâtiment. Certains reviendront. Dans les postes de soins, des mots de remerciements sont affichés, entretenant l’espoir des malades comme des soignants. « Merci d’avoir pris “soins” de moi », peut-on lire sans qu’on sache si la faute est volontaire. Lorsqu’elle dresse un bilan de ses cinq années dans le service, Delphine évoque ces deux adolescents qui se sont suicidés après leur sortie. Mais elle se souvient aussi de celui qu’elle appelle avec tendresse « notre loup-garou ». « Les nuits de pleine lune, il se transformait, poussait des cris, griffait son mur… Mais il était adorable ! Les traitements ont pu diminuer ses délires. » Un jour, il est revenu les voir pour leur annoncer qu’il avait trouvé une copine. La plus belle des victoires.
Lire aussi.Voyage au bout de l’adolescence
A l’Usaa, nous retrouvons Manon*, qui aura 16 ans demain. Pour la troisième année consécutive, elle fêtera son anniversaire dans le service. Depuis ses 12 ans, elle en est, dit-elle, « à une vingtaine d’hospit’. Un cercle vicieux, je suis en hospit’, ça va mieux, je sors, je rechute et je reviens. » Elle a encore essayé de se tuer. « C’est pas la première fois. » L’équipe lui a proposé un « placement » : « C’est peut-être la solution », convient-elle. Dans la cour carrée, elle choisit un coin au soleil sur la table où elle s’installe avec un jeu de points à relier. Le plus dur ici, c’est l’ennui. Elle ne sait pas ce que donnera son dessin. Et c’est presque une métaphore de son avenir. * Les prénoms des adolescents ont été modifiés.
Toute reproduction interdite- PRÉC
- SUIVANT